
‘‘Je vis de mon art et mon art vit de moi’’ déclare EpS au milieu de notre entretien, avant de partir dans un grand rire. C’est un extrait qui le résume assez bien : jonglant entre une conscience aigüe de sa position d’artiste, une carrière ambitieuse et une autodérision permanente, ce Libanais né en Côte d’Ivoire est à plusieurs égards un cas particulier. A 33 ans, il fait partie des premières générations de graffeurs libanais, et a réussi mieux que personne à concilier peinture ‘professionnelle’ (commissions, événements, vente de toiles…) et graffiti traditionnel, gratuit et incisif. Morceaux choisis d’une interview fleuve.
Accrocher l’œil
D’emblée, EpS semble avoir un avis bien à lui sur le rapport de la population au graffiti. Et malgré le statut de ‘grand frère’ que lui confèrent son âge et son expérience, il est bien décidé à ne pas se reposer sur ses lauriers :
‘‘Le graffiti est moins nouveau que quand j’ai commencé, les gens sont plus habitués à en voir. Il y a moins de surprise, au point qu’ils ne le voient pas autant qu’avant. Plus les années vont passer, plus il va falloir sortir du lot, changer de format, choisir des éléments qui vont accrocher l’œil pour être remarqué’’. Une
tâche à laquelle il s’attelle déjà :
‘‘J’essaye d’expérimenter sur de nouvelles surfaces, par exemple j’ai commencé à peindre sur des transformateurs électriques, sur lesquels j‘aime bien faire des portraits. Ce qui est intéressant sur ces boites métalliques, c’est leur format : le fait qu’elles soient au sol, à peu près à hauteur d’homme, et que de par leur taille elles diffèrent d’un mur : je ne peins pas une pièce sur une partie de la surface, je m’accapare l’intégralité de l’objet. Et puisqu’on peut trouver ces boites partout dans la ville, je choisis celles que les gens voient en marchant, ou qui sont au milieu de grands axes, au niveau d’un feu de signalisation, pour que les automobilistes ne puissent pas les rater. J’aime l’idée de cet objet transformé, cette manière de m’inscrire dans la ville en transformant du mobilier urbain auquel les gens ne font d’ordinaire pas attention’’.

Cette manière de penser la ville à travers le prisme de son art, EpS l’a développé au fil des années. Et ses études de design graphique ont eu sur lui une influence qu’il ne cesse de mettre en avant :
‘‘J’ai suivi le cursus de graphic design à la faculté des beaux-arts à Kaslik, où j’ai appris comment faire des logos, des catalogues, de la conception de publicité… Ça a participé à forger la façon dont je travaille, mon identité, ma façon de faire des recherches. C’est un outil : en tant qu’artiste ça m’a donné une structure qui est applicable avec tous les médiums possibles. C’est aussi une démarche en fait : tu apprends à te comprendre toi-même et à aller chercher des informations et les communiquer aux gens de manière visuelle’’.
Ce cycle d’étude et une détermination à toute épreuve ont amené EpS à atteindre une position rare : il réussi à vivre de son art, et à tirer le meilleur partit de ses diverses commissions.
Graffeur et professionnel
Les commissions, c’est malheureusement le point sur lequel trop de journalistes semblent vouloir l’interviewer. Lorsqu’on lui en parle, après quelques hésitations, EpS se lance néanmoins :
‘‘Vivre de sa passion, c’est fantastique mais ça n’est pas toujours parfait, pour des clients on fait parfois des peintures auxquelles on ne s’identifie pas vraiment. Mais c’est objectivement mieux que d’être assis dans un bureau de 9h à 18h, on apprend de nouvelles techniques, on repousse les limites… Et puis on emmagasine du matériel pour peindre à sa guise dans Beyrouth. Si j’en suis là aujourd’hui, à vivre du graffiti, avec des travaux d’envergure, c’est aussi parce que je me suis forcé à accomplir des défis. Au début de ma carrière j’étais terrifié par les projets, par leur taille ou leur réalisation. Mais à force de venir à bout d’un travail, de sortir de ma zone de confort, d’accepter des projets de plus en plus imposants, plus rien ne me fait aussi peur qu’avant. Grâce à ça, si demain j’ai envie de réaliser une façade d’immeuble entière pour Beyrouth, à mes frais, j’ai la solidité technique et le savoir qu’il me faut pour l’organisation’’.

Bien évidemment, c’est lorsqu’on parle de l’aspect ‘gratuit’ de son art qu’EpS se fait plus prolixe.
‘‘Je peins parce que c’est un besoin d’extérioriser quelque chose et de le partager avec le public. Un besoin de laisser une trace, de s’approprier un lieu qui fait partie de mon quotidien et de celui de beaucoup de gens. Faire en sorte que les gens le regardent différemment’’.
Pour ce faire, l’artiste a inventé un personnage qu’on retrouve désormais dans toute la ville : un singe, qu’il appelle César, et qu’il adapte en fonction du lieu, de l’actualité ou de sa propre vie.
‘‘L’objectif du singe, c’est d’avoir un personnage qu’on reconnaît au premier coup d’œil, comme un logo, et que je peux produire rapidement tout en gardant un aspect technique satisfaisant. C’est un personnage qui m’est cher de par son histoire, de par la façon dont il m’est venu. J’ai grandi en Afrique, dans une ville qui n’était pas une métropole, et j’ai passé énormément de temps à crapahuter dans des régions rurales, ce qui fait que je suis très attaché à la nature. Le singe est un animal avec lequel j’ai une affinité, qui m’intrigue. J’ai commencé à le dessiner en 2014, et il a beaucoup évolué depuis, en même temps que l’univers qui l’entoure. C’est souvent ma signature, je l’adapte pour délivrer des messages, arrêter les gens et les faire réfléchir sur une situation précise. César peut être un musicien, un politicien, un homme d’affaire… D’autres sont des prisonniers, des pirates, souvent tatoués, et d’autres encore représentent les forces de l’ordre, donc les soldats. Quand j’ai commencé à peindre les singes hors la loi, j’ai fait des recherches sur la signification et la symbolique des tatouages de prisonniers, et pour les soldats également, afin de concevoir et de hiérarchiser cette armée, en me servant des insignes, des grades… C’est aussi une manière de retranscrire des choses qui existent dans ce pays, que je vois dans la vie de tous les jours…’’
Le graffiti comme miroir de la société, donc. Un miroir déformant, puisque simiesque, mais qui traduit une volonté bien particulière : celle de s’approprier Beyrouth et ses habitants.

S’inscrire dans la ville
Beyrouth étant sa ville d’adoption, EpS n’y attache pas d’importance communautaire :
‘‘Je n’ai pas de préférence en ce qui concerne les quartiers où je peins. Que je sois à pied ou en voiture, je suis constamment comme un scanner, à chercher des murs en imaginant ce que je pourrai y peindre, et ce que ma peinture transmettrait aux gens à ces endroits précis’’
. Et cet état d’esprit mène à une approche singulière pour un graffeur :
‘‘Si j’estime qu’il y a trop de peinture dans un certain quartier, ça me donne plutôt envie d’aller chercher plus loin. J’aime qu’un mur soit riche, qu’il me parle. Il y a ici des murs qui ont beaucoup d’histoire. Lorsqu’ils portent des traces de la guerre, il est parfois intéressant de mettre ça en valeur différemment. Je l’avais fait sur un immeuble proche de Tayouneh. Quand on regarde une peinture classique, ou de l’art contemporain, parfois ça nous parle, parfois non. Qu’est ce qui fait qu’entre deux artistes qui font des choses similaires, l’un est coté et l’autre inconnu ? C’est la façon de voir et de retransmettre les choses. L’émotion que tu ressens en regardant la peinture se suffit à elle-même. Quand je choisis un mur, la matière, la lumière, la texture, les couleurs me parlent, m’influencent. La visibilité aussi. Dans ce qu’on fait, il y a un côté divertissement, tu veux que les gens vivent avec ta peinture, et qu’elle vive avec eux. Et l’endroit où tu vas peindre, l’orientation, tout ça y contribue. C’est mon ami photographe Bilal Tarabey qui m’avait un peu appris la recherche de lumière, savoir quel mur est au soleil à quelle heure… Mais le processus de la peinture elle-même c’est un exutoire en soit’’.
Un exutoire en constante évolution : lorsqu’on lui demande de définir son style, il trouve la question réductrice et tient à développer : ‘‘
Le style, ça n’est jamais fixe. Je suis en recherche, toujours, mais je m’oriente plutôt vers des personnages, même si j’aime les lettrages. Plus le temps passe, plus je crois qu’il y a des gains de maturité, qui sont moins espacés dans le temps. Au début la recherche était orientée sur la technique puisque je n’avais pas beaucoup d’expérience, et c’était une grosse limitation. Aujourd’hui le côté technique fait moins partie de la recherche, et j’arrive à mieux me concentrer sur ce que je veux transmettre. La forme est
suffisamment acquise pour que je puisse approfondir le fond’’.

Se permettre de rêver
Alors que notre entretien touche à sa fin, EpS tient à clarifier sa position en tant que graffeur :
‘‘Je n’ai pas la prétention de dire que je ‘dois’ apporter quelque chose à la ville. Il n’y a pas de manifesto du graffiti qui indique comment on doit se comporter. J’estime que j’ai un code de conduite qu’on est un certain nombre à partager dans les grandes lignes. Et ça se reflète dans la façon dont je délivre un message sur un mur, dans le choix des supports. Après, si je dois apporter quelque chose, c’est en provoquant une réaction chez les gens. Faire réagir, faire vivre la ville... Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas ce qu’on fait et c’est normal, ça fait avancer. Dans un environnement tel que Beyrouth, le graffiti apporte encore plus de complexité ! Et puis quand tu regardes une de mes peintures tu ne vois pas directement la crise des ordures, la crise politique, les crises religieuses… Mais l’emplacement et la manière dont la pièce est amenée te disent quelque chose. Donc en fonction du contexte et de ce que je peins, tu auras la réponse quant à mon intention’’.
Malgré son ancienneté dans l’histoire du graffiti libanais, l’artiste affirme que la discipline n’en est qu’à ses débuts, et attend fébrilement le moment où de nouvelles générations de graffeurs viendront tirer vers le haut une scène déjà unique :
‘‘Je veux que de nouveaux artistes émergent, qu’ils accomplissent ce que les première et deuxième générations de graffeurs libanais font depuis le début, en dix fois mieux. Qu’ils nous fassent aller de l’avant. C’est ça qui me donne envie de progresser, de me battre. Et puis j’ai à cœur de changer Beyrouth, de créer cette identité qui n’existait pas, de l’instaurer. Je veux me permettre de rêver plus’’.
Cette notion d’identité est centrale pour EpS, qui semble las des sempiternels clichés sur ce qu’est ‘être libanais’ :
‘‘L’identité arabe aujourd’hui, ça ne se résume pas à la calligraphie. J’en fais partie aussi, je refuse qu’on me dise le contraire. En tant que libanais, on a toujours été vers l’étranger, on a été exposés à beaucoup de cultures. Aujourd’hui je fais partie de ces Libanais qui ont cette multiculture. J’aimerais qu’on arrête de nous associer uniquement à des clichés… Moi j’ai plusieurs cultures, et un regard sur la société que j’exprime avec des outils qui sont les miens. Ils sont ancrés dans une culture africaine, européenne… Et j’aimerai pouvoir les exprimer en tant que Libanais’’.
Instagram: Apocaleps_

 A propos de l'auteur Boutros al Ahmar |
ARTICLES SIMILAIRES

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery
09/04/2024

À la découverte des « Murmures de la nature » de Ghassan Zard à la Galerie Tanit
Garance Fontenette
28/03/2024
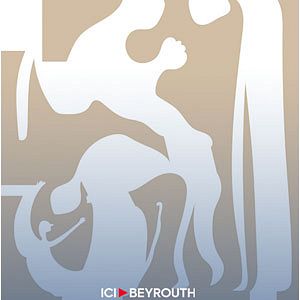
Espaces en évolution: l’art de Nadim Karam
28/03/2024
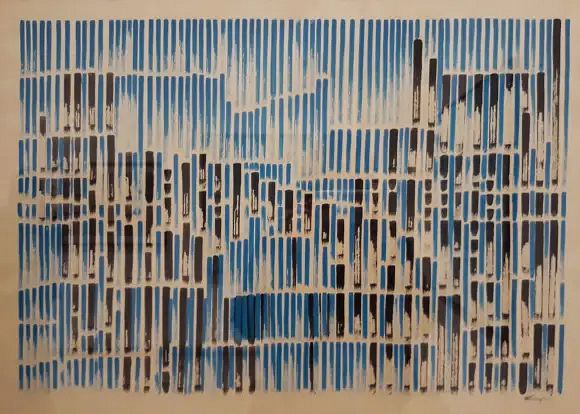
Oumaya Alieh Soubra, Puissante et Inspirante
Brigitte Labbé
27/03/2024

Bassam Geitani nous emmène « Dans le creux du chaos » à la Galerie Janine Rubeiz
Garance Fontenette
22/03/2024

Je vous écris du Caire : Inauguration de la galerie d’Art Al-Mashhad
Léa Samara
14/03/2024

Mona Nahleh explore les « réalités parallèles » à la galerie Maya Art Space
Garance Fontenette
13/03/2024

PLONGEZ-VOUS DANS LES PAGES DU AC #599
Myriam Nasr Shuman
07/03/2024
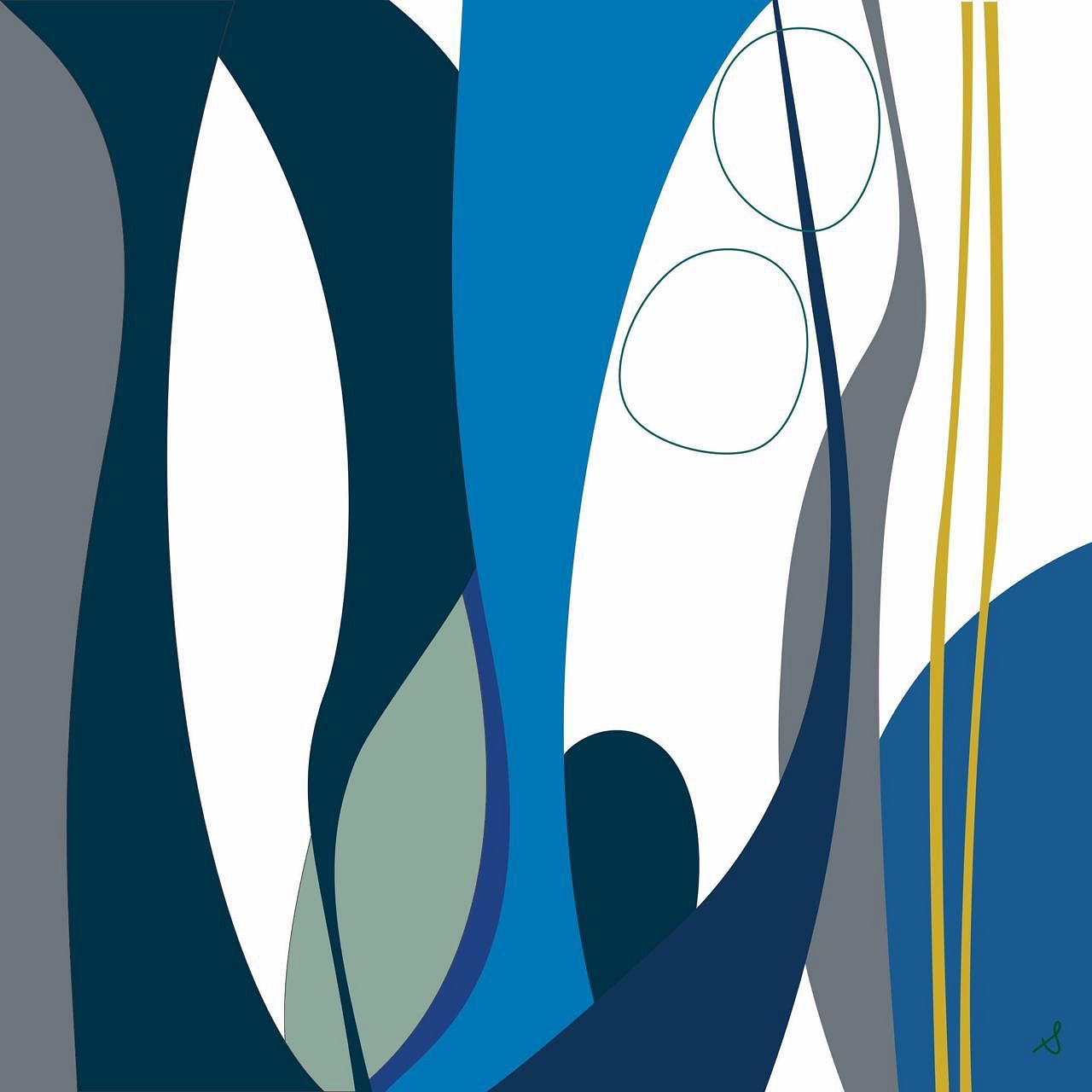
Collaboration entre Artists of Beirut et l’entreprise française Inaltera
Garance Fontenette
04/03/2024

Vente de la collection de Nada Takla
Garance Fontenette
29/02/2024
