
‘‘Le graffiti, c’est une question de partage et de communication. Dès l’instant où il est partagé, il commence à exister’’. La notion de partage. C’est ce qui revient le plus dans les propos d’Exist, libanais de tout juste 23 ans et l’un des artistes les plus prolifiques que les rues de Beyrouth aient connues. Son nom est omniprésent, son style aisément reconnaissable. Et sa vision du graffiti en tant que vecteur d’unité donne à réfléchir. C’est en plein cœur de Geitawi que nous le rencontrons, le temps de quelques cafés et de nombreuses cigarettes. Le ton est calme, posé, les mots sont choisis avec soin. Au cœur de chaque réponse, une ligne directrice : sa ville. ‘‘Ça fait seulement six ans que je vis à Beyrouth, mais plus j’y peins, plus elle m’influence et j’ai parfois l’impression d’y avoir toujours vécu. Je la connais bien, je connais ses habitants, sa manière de fonctionner. C’est une ville faite de contradictions, et c’est en partie ce qui lui donne sa personnalité : On l’aime et on la déteste en même temps, on voit les riches, les pauvres, le fossé entre les deux, l’irresponsabilité des politiques et des citoyens…’’

Évoluer à Beyrouth
Sa vision de la ville se reflète dans ses choix artistiques : ‘‘Je préfère en général peindre dans des quartiers populaires, qui ont un sens de l’entraide et la volonté de vivre ensemble plutôt que chacun chez soi. Des quartiers où les gens sont accueillants, même lorsqu’on vient d’une communauté différente. Mais c’est quelque chose que l’on est plusieurs à partager : dans les artères commerçantes, on voit plus de ‘tags’, de graffitis rapides et efficaces, tandis que dans les coins plus calmes, plus résidentiels, on peut trouver davantage de graffitis complexes, sur lesquels les artistes ont passé des heures à peaufiner les détails…’’ Le choix du ‘spot’, de la surface à peindre, est donc primordial. Et il est le fruit d’une évolution, au prix de quelques erreurs : ‘‘Quand j’ai commencé, je n’avais aucune idée des règles, des possibilités… J’ai beaucoup taggé sur de vieux murs, de belles maisons, des véhicules. Aujourd’hui en revanche, avec l’expérience que j’ai accumulée, je ressens une forme de responsabilité. Je considère toujours les tags comme un art, et j’en ferai toujours sur des murs en parpaings, sur des affiches de politiciens ou de publicité et ailleurs, mais j’estime que si je dois faire un vrai graffiti quelque part, il doit ajouter à son environnement, et pas le dégrader. Si je veux peindre sur un immeuble en parfait état, ou un beau mur en pierre, je demande souvent la permission au propriétaire, même si le reste du temps j’estime que le graffiti est quelque chose qui est imposé, et qui doit choquer, être inattendu. Mais en général je préfère trouver un immeuble récent jamais terminé, un mur rouillé ou endommagé, et l’améliorer avec ma peinture. Je crois qu’on est une majorité de graffeurs à penser comme ça aujourd’hui, et c’est une bonne chose’’.

Une question d’identité
La scène libanaise, qui compte moins d’une dizaine d’artistes ‘actifs’, est effectivement parvenue à un stade de maturité que lui envieraient nombres de capitales.
‘‘Embellir la ville est une part énorme de notre travail de graffeurs, même si nous n’en parlons pas beaucoup entre nous. On se concentre plus sur les aspects techniques, les styles… Mais qu’on le veuille ou non, on modifie l’identité visuelle de la ville, de son architecture, de ses rues. Selon le quartier de Beyrouth où vous marchez, vous pouvez voir des façades d’immeubles entièrement peintes, ou des minuscules bouts de murs que presque tous les artistes locaux ont signés de leurs noms. Pour moi, c’est un élément central de la personnalité d’une ville, que l’on parle de tags ou de personnages, de calli-graffiti ou de lettrages traditionnels. Et à Beyrouth, c’est incroyable d’avoir tant d’œuvres de qualité, dans presque toute la ville. C’est surtout parce-que les graffeurs locaux ont aujourd’hui tendance à privilégier la qualité plutôt que la quantité, au contraire de ce qui se fait à l’étranger. Ça donne une scène plus organisée, plus respectueuse en général’’.

Beyrouth comme toile, comme ‘‘terrain de jeux’’ aussi, Exist le souligne dans un sourire. Et qu’en est-il de sa propre identité ? La place de celle-ci est fondamentale, dans son œuvre comme dans son discours : ‘‘J’ai commencé à signer Exist il y a 6 ou 7 ans, d’abord parce-que j’aimais l’idée que mon nom d’artiste puisse être utilisé comme un verbe, comme une injonction. Puis avec les années j’ai découvert que ça définissait aussi l’activité de tout graffeur : exister en laissant une trace, mettre un peu de soi même sur les murs. J’écrivais en lettres latines simples, c’est ce qui me fascinait le plus : donner du mouvement, du ‘flow’ à des lettres sans sacrifier leur lisibilité. Puis en 2016 je suis passé aux lettres arabes. Et petit à petit la lisibilité à cessé d’être une priorité, en ce moment je déforme les lettres jusqu’à l’abstrait, j’essaye d’y mettre mon ressenti, mon expérience, mes envies, et d’aller au-delà du mot lui-même. C’est très important pour moi’’.
Mais malgré la direction abstraite qu’a prise son travail, il lie toujours ce dernier au graffiti traditionnel, et à sa langue maternelle.
‘‘Je trouvais ça naturel de me rapprocher de ma culture, ça m’aide à faire passer mon message. Et je crois que c’est notre devoir, en tant qu’artistes arabes, de préserver notre culture, nos valeurs, donc c’est ce que j’essaye de faire, à ma petite échelle. J’écris le mot anglais ‘Exist’ en lettres arabes, ce qui est très libanais au final !''
s’amuse-t-il, avant de poursuivre, l’air soucieux :
''Nous, Libanais, avons tellement absorbé de culture étrangère, que nous avons tendance à oublier la nôtre. Et j’ai l’impression que de plus en plus d’artistes en tous genres commencent à remarquer ça, et à changer en conséquence.’’

Le ‘laisser passer’ graffiti
Cet attachement à sa culture, à ses concitoyens se ressent également dans ses habitudes de graffeurs : ‘‘Puisque je suis plus confiant, j’appréhende les murs et les gens de manière différente aujourd’hui. Leur réaction quand ils me voient peindre est largement positive, et ça ne fait que s’améliorer. On se faisait arrêter plus souvent dans le passé, par la police, ou des gens ‘responsables’ de tel ou tel quartier, parce qu’il y avait une ignorance généralisée vis-à-vis du graffiti. Mais depuis quelques années de plus en plus d’habitants viennent nous poser des questions avant de porter un jugement sur ce qu’on fait, ils s’intéressent à ce qui nous motive, ce que l’on essaye de dire. Et même lorsqu’ils n’apprécient pas, il y a toujours un dialogue, un échange’’. Il précise qu’au vu de l’amélioration indéniable du talent des graffeurs, il est normal de voir la réaction du public s’adapter : ‘‘On est loin des gribouillis de nos débuts, par conséquent les personnes qui sont témoins de notre processus de travail se rendent vite compte qu’ils assistent par exemple à la réalisation d’un portrait, ou que les lignes sont précises, propres, que les gestes sont professionnels… Et quand je dis aux gens que j’écris en arabe, même lorsqu’ils ne peuvent pas déchiffrer mon travail, ça accentue leur curiosité, ils s’identifient davantage à mes peintures. Je leur explique que pour moi mon art est une expression de mon histoire, ma façon d’influencer leur vie même de manière infime’’.

Des échanges qui lui sont précieux
: ‘‘Chaque fois que je peins dans ces quartiers où je ne vis pas, j’en profite pour discuter, et voir où en est mon pays. Les gens sont ils toujours bloqués dans la mentalité intolérante, communautariste et soupçonneuse héritée de la guerre ? Vont-ils me demander mon nom de famille ? Et quand je reviens d’une session graffiti avec d’autres artistes d’ici, je suis très souvent soulagé. Peindre entouré de gens qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas de ma propre communauté mais qui tolèrent ma présence, qui échangent avec moi, c’est ce qui me motive. Et bien sûr, peindre avec mes amis graffeurs, qui eux aussi sont chrétiens, druzes, sunnites, chiites… J’aimerais que ça soit un exemple, pas seulement pour les artistes mais pour tout le monde’’.
Au Liban et au-delà
Quand on évoque l’avenir, Exist semble optimiste, en ce qui concerne le graffiti au moins :
‘‘En plus de nos peintures commissionnées, de nos graffiti, nous sommes plusieurs à participer régulièrement à des projets en lien avec des ONG, des associations… C’est un plaisir et un honneur d’être choisi pour aider une bonne cause quelle qu’elle soit. En ce qui concerne la scène graffiti Beyrouthine, je crois que c’est un des signes qu’elle va dans la bonne direction, et je suis très fier d’en faire partie. De plus en plus d’artistes étrangers viennent peindre à Beyrouth, car la réputation de la ville est excellente, et nous-même voyageons de plus en plus grâce au graffiti : c’est devenu notre passeport, comme dirait un ami, nous sommes invités chaque année au Brésil, en Europe, pour participer à des festivals, rencontrer d’autres artistes, partager nos expériences… J’espère qu’à l’avenir, Beyrouth sera reconnue comme une ville majeure du graffiti à l’échelle mondiale. Que les artistes étrangers sauront que leur art sera protégé et apprécié à sa juste valeur s’ils viennent ici. Que le Liban sera enfin plus reconnu pour son art, sa culture, que pour ses travers et son histoire récente. Que mes compatriotes finiront enfin par comprendre que l’unité est la seule solution’’.
Il se tait, hésite. ‘L’égoïsme mène à l’ignorance’.

Nous avons parlé près de deux heures. Il fait maintenant nuit noire, le cendrier est plein, les gorges sèches. Exist se remet doucement à travailler sur son dernier projet personnel : son nom en arabe stylisé, constitué de dizaine de petites pièces de bois colorés, qu’il a fait découper et qu’il s’applique à présent à reconstituer, pour en faire un graffiti miniature en 3D. Alors qu’il colle une à une les pièces finement taillées, on prend congé, certain d’avoir eu affaire avec une étoile montante de la culture libanaise, dont on ferait bien de surveiller le futur avec attention.
Pour suivre le travail d’Exist:
Facebook : Exist Ai
Instagram : Exist_ai
 A propos de l'auteur Boutros al Ahmar |
ARTICLES SIMILAIRES

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery
09/04/2024

À la découverte des « Murmures de la nature » de Ghassan Zard à la Galerie Tanit
Garance Fontenette
28/03/2024
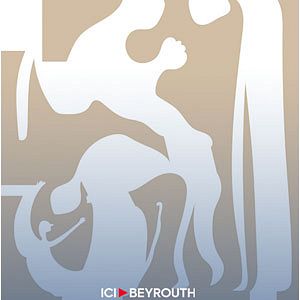
Espaces en évolution: l’art de Nadim Karam
28/03/2024
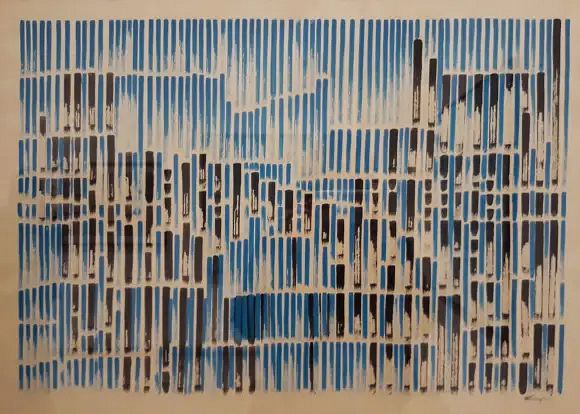
Oumaya Alieh Soubra, Puissante et Inspirante
Brigitte Labbé
27/03/2024

Bassam Geitani nous emmène « Dans le creux du chaos » à la Galerie Janine Rubeiz
Garance Fontenette
22/03/2024

Je vous écris du Caire : Inauguration de la galerie d’Art Al-Mashhad
Léa Samara
14/03/2024

Mona Nahleh explore les « réalités parallèles » à la galerie Maya Art Space
Garance Fontenette
13/03/2024

PLONGEZ-VOUS DANS LES PAGES DU AC #599
Myriam Nasr Shuman
07/03/2024
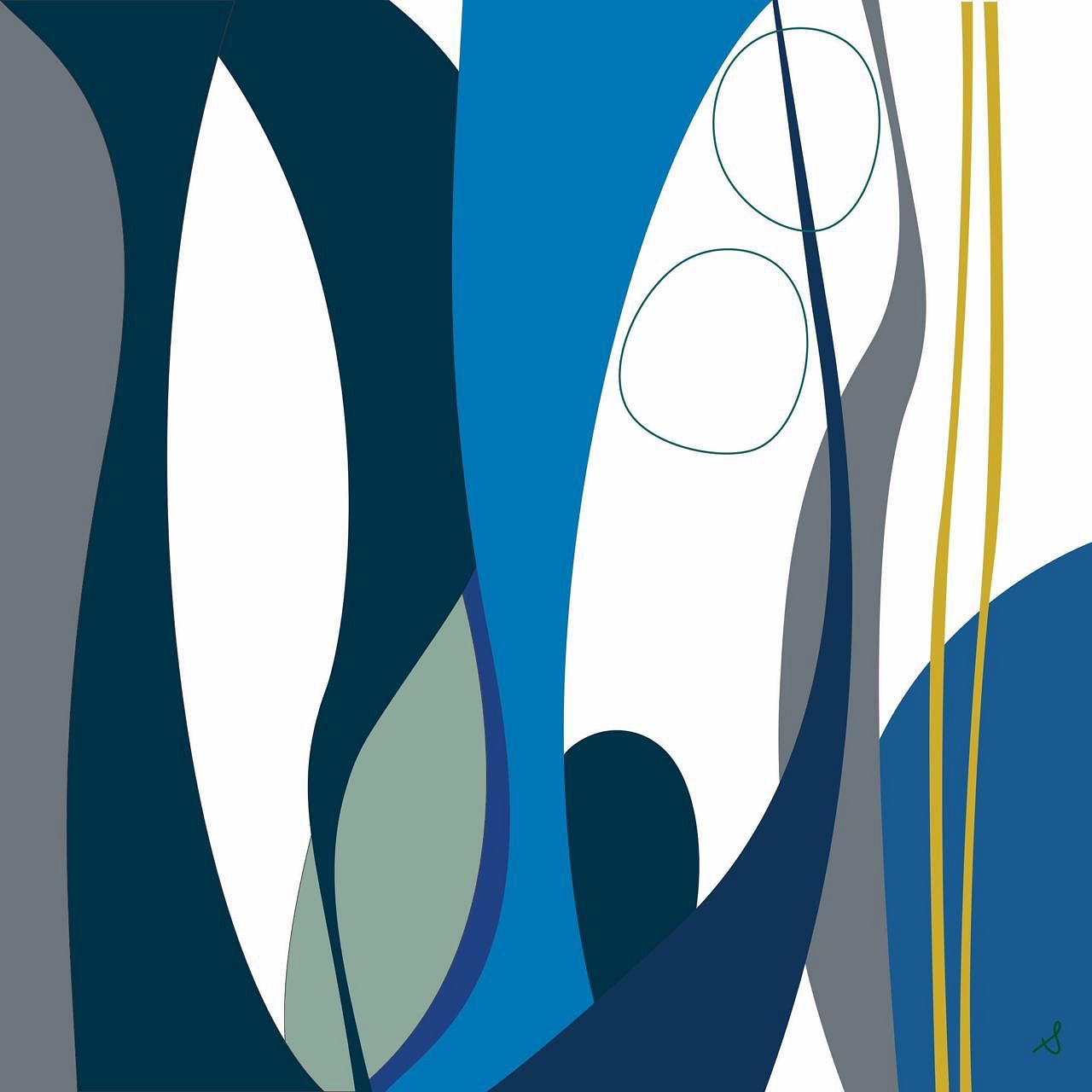
Collaboration entre Artists of Beirut et l’entreprise française Inaltera
Garance Fontenette
04/03/2024

Vente de la collection de Nada Takla
Garance Fontenette
29/02/2024
