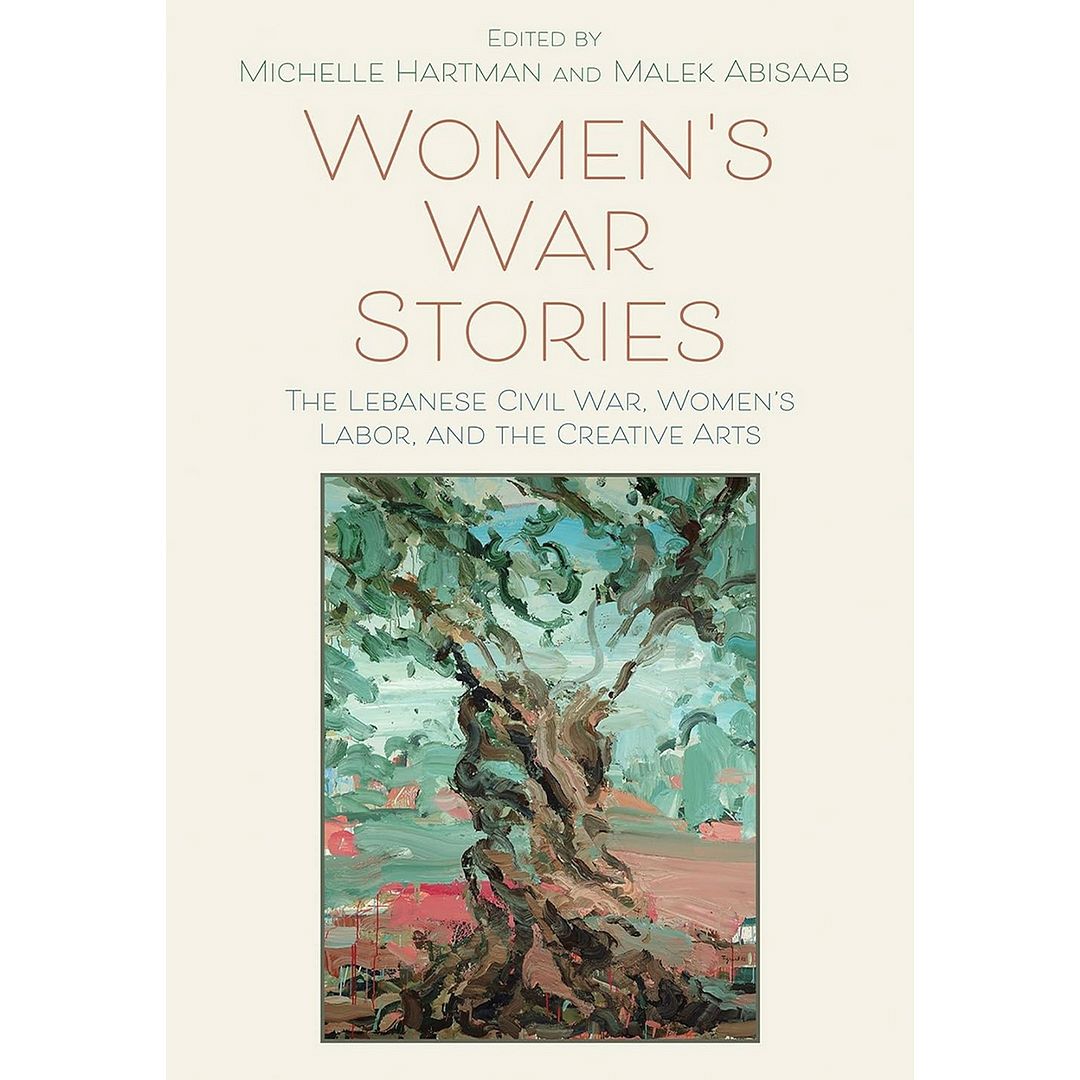
Entre Amnistie et Amnésie : voix de femmes et mémoires d’artistes à la conférence « Breaking silence »
02/04/2025|Mathilde Lamy de la Chapelle
Le 19 mars dernier s’est tenue à la Lebanese American University (LAU) la table-ronde « Breaking Silence: Art, Women and the Lebanese Civil War », co-organisée par Institute of Art in the Arab World (IAAW) et Arab Institute for Women. S’appuyant sur l’ouvrage Women’s War Stories: the Lebanese Civil War, Labor and the Creative Arts, dirigé par les professeurs Michelle Hartman et Malek Abisaab, cet évènement a été l’occasion de plonger dans l’œuvre d’artistes libanaises marquée par la guerre civile de 1975. En exprimant par l’art leurs traumatismes, ces femmes ont livré de précieux témoignages des horreurs de la guerre, ancrant son souvenir pour éviter qu’elle ne se répète.
Deux essais ont été présentés par leurs auteurs, Yasmine Nachabe Taan et Zena Meskaoui. La présentation de Meskaoui a consisté en une explication et une discussion de l'œuvre d'art Appendice de Lina Majdalanie, qui fait l'objet de son chapitre dans le livre. L'intervention de Taan s'est concentrée sur son propre chapitre, une exploration de l'art de trois femmes artistes libanaises de différentes générations qui réfléchissent à leur expérience de la guerre et à leur production artistique.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Ces trois femmes, chacune de générations différentes, ont été interviewées par Yasmine Nachabe Taan, professeure associée d’art et de design à la LAU et directrice de l’IAAW.
La sculptrice et peintre Ginane Makki Bacho était présente à l’évènement. Née à Beyrouth en 1947, elle part se former à New York en 1984 où elle suit une formation de peinture et de gravure à l’Institut Pratt. Ses premières œuvres restent marquées par les dix années de guerre vécues au Liban, où elle retourne en 2000. Depuis, l’artiste a continué de raconter l’histoire de son pays, notamment par ses sculptures en métal.
La céramiste Samar Morghabel a également répondu aux questions du public. Née en 1958 à Beyrouth, Morghabel découvre puis développe sa propre approche de la céramique auprès de deux autres femmes artistes libanaises, Dorothy Salhab Kazemi et Greta Naufal. Elle conçoit son œuvre comme un journal de bord, dans lequel se lisent successivement les différents évènements liés la guerre au Liban.
Enfin, l’ouvrage retrace le parcours de Tagreed Darghouth, née à Saida en pleine guerre civile. Formée à l’Académie libanaise des Beaux-Arts puis à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, son œuvre est profondément marquée par l’actualité libanaise et le sort du peuple palestinien auquel elle dédie sa série « The Tree Within, A palestinian Olive Tree ».

L’espoir ou le chaos : une guerre à travers le regard des artistes
Nées de la guerre et dans la guerre, les œuvres de ces femmes n’en demeurent pas moins singulières par leur manière de la représenter. Si certaines dépeignent les conséquences des conflits dans toute leur cruauté, afin d’en livrer le témoignage le plus fidèle, d’autres choisissent de célébrer l’espoir, comme pour « sublimer » la guerre et l’absoudre de sa violence.
Les fameux « cèdres » de Ganine Makki Bacho entrent dans cette seconde catégorie. Touchée par l’attaque israélienne de 1982, l’artiste a collecté les éclats d’obus qui avaient pénétré violemment son appartement pour ensuite les assembler en sculptures de cèdres, transformant des instruments de morts en objets d’art, en symboles du Liban et de la vie éternelle.
Le travail de Samar Morghabel reflète, quant à lui, la réalité crue des conflits. À la suite de l’attentat de 2005 responsable de la mort du président Hariri, l’artiste modèle une série de voitures piégées. Au-delà de ses œuvres, c’est son approche artistique tout entière qui est marquée par la brutalité. Elle travaille violemment l’argile, la martèle, la brise. Une manière pour Morghabel d’affronter la mort. Présente à la table-ronde, elle se livre sur la manière dont, vidant les voitures sculptées des résidus de terre séchée, elle a la sensation d’en sortir les corps déchiquetés. Reproduire la violence n’est ici pas un acte « gratuit », une forme de fascination pour la mort. C’est une nécessité, un acte de vie. La création poursuit un effet cathartique au sens où l’entendait Aristote, c’est-à-dire revivre la catastrophe pour tenter de se l’approprier et, in fine, de la dépasser.
Peindre la guerre : l’art comme outil de résistance face au silence collectif
Pour parvenir à la catharsis, individuelle mais aussi collective, l’art est bien plus efficace que les mots. Il permet de donner à voir l’inénarrable et pallie le silence assourdissant du discours officiel se refusant à affronter « un passé qui ne passe pas ». Il offre un espace de liberté pour aborder la guerre, abolit les interdits, et donne la possibilité de changer notre regard sur un passé commun.
Toutefois, si ces femmes ont fait preuve d’assez de courage et de résilience pour entreprendre de lever le voile sur les atrocités de la guerre, chacun n’est pas prêt à emboîter le pas, et ce que l’artiste peut créer, le spectateur n’est pas toujours en mesure de le regarder.
Tagreed Darghouth en a fait le constat. Préparant son exposition « Analogy to Human Life », l’artiste a recouvert ses toiles rouge vif, comme ensanglantées, destinées à dénoncer les massacres des palestiniens, par d’épaisses couches d’acrylique vert avant d’y peindre de majestueux oliviers. Les tableaux recouverts ne laissent entrevoir que d’infimes traces des toiles originelles, comme symbole d’une réalité qui continue d’être enfouie. La représentation de l’espoir, plus décente que celle de la mort, s’impose à l’artiste. Force est de constater que si l’art permet d’exprimer davantage que les mots, il ne peut parvenir à briser tout à fait le silence. La pudeur résiste comme dernier rempart.

De la guerre à la création : femmes, victimes, résistantes
La conférence « Breaking silence » s’inscrit dans une longue réflexion sur le rôle de l’artiste au sein de la société. La représentation par ces trois femmes de la guerre civile libanaise comme des conflits qui l’ont suivie – ou plutôt prolongée – est évidemment un acte de résistance et de contestation.
Toutefois, ces artistes n’ont pas choisi d’endosser ce rôle, ni de porter cette voix. La guerre s’est imposée à elles comme seul sujet possible en envahissant l’espace-temps auquel elles appartiennent. À la question « Qu’auriez-vous modelé si vous n’aviez pas vécu la guerre ? », Samar Morghabel répond : « Simplement des pots », qui soient utiles, fonctionnels et agréables à regarder.
Ainsi, la résistante n’en demeure pas moins victime et les œuvres de ces femmes expriment toute leur colère face à leur impuissance. Écartées des responsabilités politiques et militaires, elles n’ont pas choisi les combats mais les ont ressentis dans leurs chairs et dans celles de leurs enfants. Leurs pinceaux et leurs mains comme seules armes.
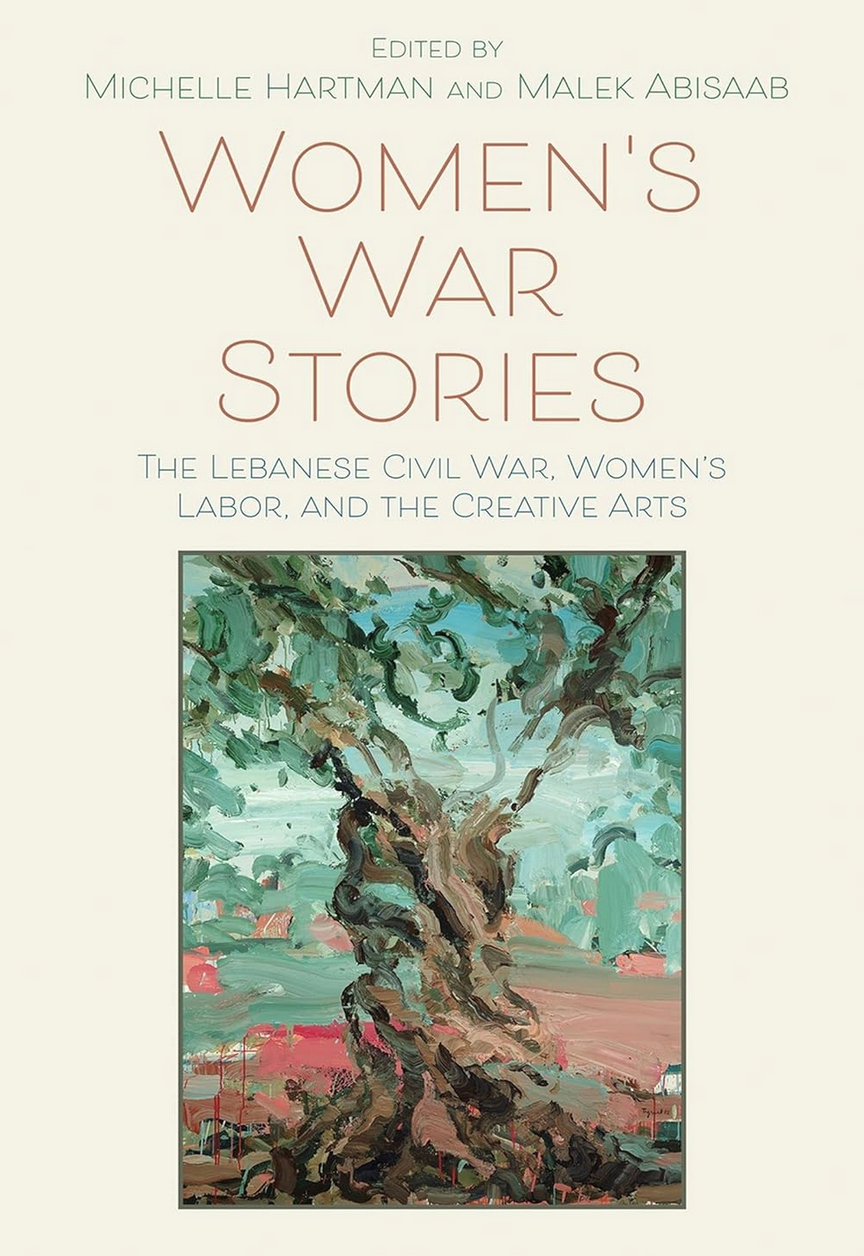
ARTICLES SIMILAIRES

Agenda Culturel #610 du 23 avril au 19 mai 2025
24/04/2025

Les rendez-vous d’« Horeca » : rencontre avec Alan Geaam
Mathilde Lamy de la Chapelle
16/04/2025

Les rendez-vous d’« Horeca » : rencontre avec Guillaume Gomez
Mathilde Lamy de la Chapelle
16/04/2025

Les rendez-vous d’« Horeca » : rencontre avec Christian Heuline
Mathilde Lamy de la Chapelle
16/04/2025

Lancement de la fondation « Femmes Leaders Francophones », pour des voix féminines, fortes et légitimes
15/04/2025

Le temps qui nous reste
Ramzi Salman
14/04/2025

Mayrig Bistrot Genève: From Armenia with Love
Noha Baz
13/04/2025

Décourvir l'Agenda Culturel du Liban en France #6
08/04/2025

Huitième Conférence MoU ONU-Universités Partenaires. "Les professions langagières adoptent le changement"
08/04/2025

La table des philosophes
02/04/2025
