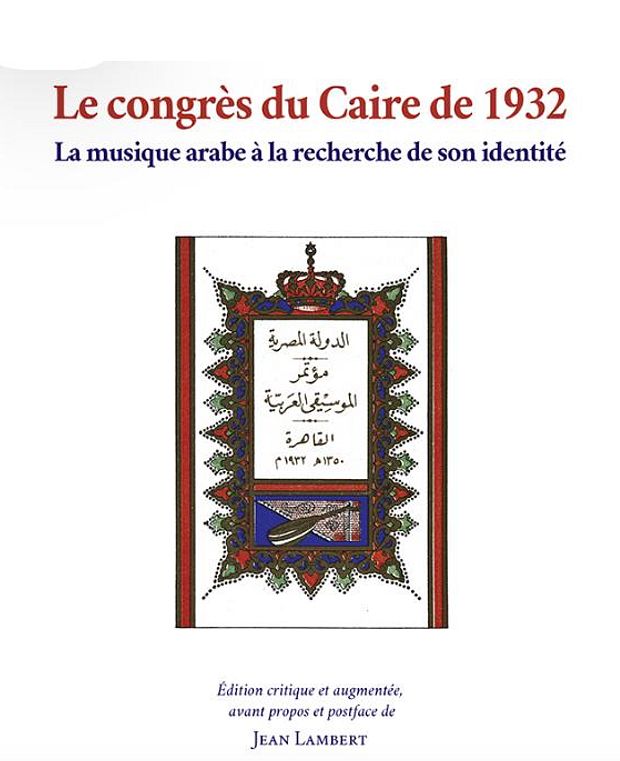
Enjeux du Congrès de la musique du Caire de 1932
11/02/2025|Zeina Saleh Kayali
Bernard Moussali (1953-1996) était un brillant historien de la musique, disparu prématurément à l’âge de 46 ans. Ses travaux étaient consacrés au Congrès de musique arabe du Caire de 1932 qui, premier du genre, avait pour ambition de structurer la musique arabe moderne. Moussali avait laissé une thèse de doctorat inachevée sur le sujet, qui était restée lettre morte depuis 1996. Le musicologue Jean Lambert a repris le manuscrit et l’a édité en y ajoutant les éléments apportés par la recherche de ces dernières années. Il en résulte un ouvrage passionnant et nécessaire paru aux éditions Geuthner et qui jette un éclairage nouveau sur un événement fondateur, une époque et une région. Jean Lambert répond aux questions de l’Agenda culturel.
L’apport majeur de la thèse de Bernard Moussali est le récit historique et synthétique des débats du Congrès du Caire, ainsi qu’une documentation détaillée et complète des enregistrements musicaux. Cela n’avait jamais été fait avant lui ?
Non, effectivement, les débats du Congrès, notamment sur les instruments à adopter, et surtout sur l’existence ou non d’une échelle musicale arabe, n’avaient été évoqués que de manière marginale, notamment par quelques collègues dont Schéhérazade Hassan et Philippe Vigreux, ce dernier ayant établi une très intéressante revue de presse du Congrès (malheureusement encore inédite). Ces sujets avaient été évoqués dans un colloque de 1989 et un livre du CEDEJ du Caire paru en 1992. Mais aucune étude d’ensemble des débats n’avait été entreprise à travers une lecture serrée des sources arabes ; seul était connu le gros volume intitulé “Recueil des travaux du Congrès” qui avait été publié en 1934, et qui, n’incluant pas ces débats, donnait du Congrès une image très lisse, très officielle. Bernard Moussali a donc recoupé tous les témoignages postérieurs pour comprendre les positions des uns et des autres, que l’on peut résumer par une confrontation entre “conservateurs” et “modernistes”, clivages qui scindaient d’ailleurs aussi bien les musicologues égyptiens que les musicologues européens ! Et entre ces deux pôles, il faut apporter de nombreuses nuances, car souvent, certains ont changé de position sur certains points, et d’autres étaient assez désorientés. On aboutit alors à une reconstruction vivante, foncièrement humaine de cet événement qui avait été perçu jusque-là comme figé ou comme figeant la musique arabe à venir.
L’apport de Bernard Moussali a également été essentiel à la publication de l’intégrale des enregistrements du Congrès (18 heures de musique sous forme de Cds), que j’ai publiée à partir de ses notes et des enregistrements originaux de la Bibliothèque Nationale de France en 2015.
L’un des buts du Congrès du Caire était de résoudre le problème de l’échelle de la musique arabe. Pour certains, elle devait se composer de 24 quarts de tons égaux comme le prônait déjà Mikhail Mishaqa au 19e siècle au Liban ?
En effet, mais ce qu’il faut comprendre, c’est que la théorie de Mishaqa, dont nous ne savons pas vraiment si nous pouvons la lui attribuer, à lui ou à un autre, était parvenue aux oreilles des musicologues égyptiens du début du XXe siècle, soit cent ans après, selon des canaux que nous ne connaissions pas bien, du fait qu’elle n’était jamais citée par les participants du Congrès. B. Moussali, ainsi que moi-même avons pu retrouver certains de ces canaux culturels. Donc, pour les modernistes, cette échelle de 24 quarts de ton visait à simplifier le problème de l’échelle, qui avait, et qui a toujours eu plusieurs variantes, entre Le Caire, Damas, Alep et Bagdad. La différence est principalement liée au placement de certains doigts sur les cordes du luth (oud) pour produire ce qu’il est convenu d’appeler les notes “sika”, c’est à dire produisant un intervalle approximatif de 3/4 de ton, qui est plus ou moins élevé dans les différentes traditions régionales. Les conservateurs ont donc voulu défendre ces spécificités locales, ce qui allait à l’encontre de la grande vague de modernisation provoquée par l’apparition de l’enregistrement, de la radio et du cinéma, et qui passait nécessairement par une unification.
Pourquoi cela fut-il réfuté par Wadia Sabra qui présidait la délégation libanaise du Congrès ?
Comme il était la fois arabophone et francophone, et bon connaisseur des deux cultures musicales orientale et occidentale, il était l’un de ceux qui pouvaient le mieux comprendre la complexité des enjeux. Au Congrès, il était le seul musicologue professionnel, arabe non-égyptien (et présidant la délégation officielle de son pays), ce qui lui donnait une importante légitimité. Ṣabrâ était aussi l’inventeur d’un piano à 24 quarts de ton. Cependant, au Congrès, il se prononça in fine contre la simplification du système scalaire par une division à 24 quarts de ton égaux que cet instrument aurait induit. Son intervention à la commission de l’Échelle, à la fois véhémente et éloquente, joua un grand rôle dans l’échec des partisans de cette théorie au Congrès. Ṣabrâ sera finalement le créateur d’un système de « l’ Échelle arabe vraie », qui faisait appel à 90 divisions de l’échelle, mais qui restera largement inédit. On peut douter de la pertinence d’un tel système, car l’extension d’un aussi grand nombre de divisions devait nécessairement lui faire perdre de son efficacité pratique. Du moins pour l’époque, car on peut aussi le voir comme un visionnaire : de nos jours, la numérisation du synthétiseur permet de produire des intervalles aussi fins. Certes, avec une perte de la beauté du son acoustique...
Le terme de « musique arabe » n’allait pas de soi avant le Congrès de 1932 car l’on parlait plutôt de « musique orientale ». Quelle est la différence ?
C’est toute la problématique du Congrès, mais comme un arrière-plan inconscient. Jusqu’à quelques années auparavant, on ne parlait que de “musique orientale”, parce que l’on vivait toujours sur la lancée de la musique de cour ottomane, l’empire ottoman n’ayant disparu officiellement qu’en 1924 (soit huit ans avant le Congrès). A cette époque les musiques arabes du Caire, de Damas, d’Alep et d’ailleurs, conservaient leurs spécificités, mais elles n’avaient pas la visibilité que leur aurait apporté un mécénat d’état. C’est une question très politique, qui lie étroitement ce qu’il est convenu d’appeler “la musique d’art” avec un pouvoir étatique, quelque qu’il soit. Seule la musique en Egypte avait connu un tel mécénat de la part des Khédives, mais de manière assez tardive, et pas encore indépendante vis-à-vis de la Sublime Porte, subissant donc toujours l’influence musicale de Constantinople. Toujours est-il que le Congrès manifesta ce désir d’indépendance culturelle vis-à-vis de l’héritage ottoman, mais tout en souhaitant adopter et intégrer toute la partie instrumentale (les bashraf et les samâ‘î), des pièces composées dont les auteurs étaient majoritairement des Turcs, des Arméniens, des Grecs et des Juifs. L’acteur clef, mais très discret de cette “arabisation” du répertoire instrumental, c’est ‘Alî al-Darwîsh, musicien, joueur de nây originaire d’Alep, qui avait été formé à l’école ottomane, et qui fut ensuite recruté par l’Institut de Musique Orientale du Caire pour faire ce travail, tout en collaborant avec le Baron d’Erlanger (un mécène et musicologue français) pour préparer le Congrès. Sur le plan musical, le style arabe se caractérisera désormais par un tempo plus rapide des bashraf et des samâ’î.
Comment les compositeurs occidentaux invités au Congrès ont-ils été accueillis ?
Dans l’ensemble, ils furent très bien accueillis. Mais parmi les participants européens (il n’y avait pas d’Américains), il faut distinguer : d’une part les compositeurs et musicologues qui ne connaissaient pas, ou peu l’Orient, comme Henri Rabaud, Paul Hindemith ou même Bela Bartok ; et d’autre part les musicologues spécialisés sur le monde arabe, comme Henry Farmer, Robert Lachmann, le père Xavier Collangettes et Alexis Chottin, qui furent accueillis à bras ouverts ; en effet, ils apportaient un savoir inestimable, y compris sur les textes arabes anciens de Farabi et d’Avicenne, qui n’avaient pas encore été étudiés selon les méthodes modernes dans le monde arabe. Seul le baron d’Erlanger ne fut pas présent, pour des raisons médicales (d’Erlanger, dont il faut rappeler que les éditions Geuthner avaient commencé à publier son œuvre magistrale, La musique arabe, à partir de 1930, et l’a rééditée en 2000). Cependant, il y avait un décalage, car les Européens spécialistes avaient tendance à valoriser la musique traditionnelle, qu’ils considéraient comme la plus caractéristique de la culture arabe, alors que les musicologues, surtout les Egyptiens, avaient des ambitions modernistes et étaient surtout fascinés par les orchestres symphoniques européens. Cela donna donc l’occasion d’un malentendu remarquable, car ces regards étaient à front renversé.
Pourquoi les musiciens du Golfe n’ont-ils pas été invités au Congrès du Caire ?
On ne s’en rend pas compte aujourd’hui, mais la plus grande partie de la Péninsule arabique était encore très peu en contact avec l’extérieur. L’Arabie saoudite venait à peine de se constituer et elle était puritaine. Le Yémen était lui aussi un état théocratique et isolationniste. Les pays du Golfe n’étaient encore que des comptoirs commerciaux occupés par les Britanniques et tournés vers l’Inde. Les Européens ne découvrirent leurs musiques que bien plus tard, et les Arabes encore plus tard. Ceci représenta évidemment une des limites “arabes” du Congrès.
Les débats du Congrès du Caire soulèvent la question de l’identité culturelle arabe. Que laisse le Congrès du Caire comme héritage ?
En effet, c’est ce qu’exprime le sous-titre de l’ouvrage : “La musique arabe à la recherche de son identité”. C’est moi-même qui ai formulé ce sous-titre, mais je pense que Bernard Moussali serait arrivé à peu près à la même conclusion s’il avait achevé son travail : il insistait sur la dualité existante entre l’unité et la diversité des traditions arabes, du Maghreb jusqu’à l’Irak et le Golfe, en passant par l’Egypte. Il soulignait, avec Philippe Vigreux, le caractère central de l’Egypte, non seulement sur le plan géographique mais aussi sur le plan politique et culturel. Cela signifiait que l’Egypte cherchait à imposer une version de la musique arabe qui était fondamentalement égyptienne, et qui faisait peu de cas des autres traditions “régionales”. Cette intuition fut confirmée ensuite par la dérive de la composition arabe moderne (Mohammed Abd al-Wahhab, Umm Kalthum, etc....) vers une musique de variétés. Donc, en termes de contenu, “l’héritage” s’est largement évaporé ! De même, les musiciens marocains et tunisiens, immédiatement après leur retour du Caire, travaillèrent à la création d’une musique marocaine (Congrès de Fès de 1930) et d’une musique tunisienne (création de la Rachidiya en 1934). C’est donc un paradoxe majeur que l’expérience du Congrès du Caire, en dépit de son approche panarabe, eut pour conséquence la duplication de son modèle pour chaque pays arabe séparément, autrement dit, qu’elle contribua à accentuer la division des Arabes sur le plan musical.
Donc, sur le plan idéologique, on peut dire que le Congrès du Caire est l’acte de naissance du panarabisme musical, et qu’à ce titre, il était presque en avance par rapport au panarabisme politique. On peut presque lire dans les débats du Congrès ce que sera le Nassérisme deux ou trois décennies plus tard, en particulier ses échecs, ce qui est assez frappant ! Cela nous montre, peut-être de manière contre-intuitive, que l’étude de la musique, un domaine en apparence si spécifique, nous permet de mieux comprendre les ressorts profonds d’une société.
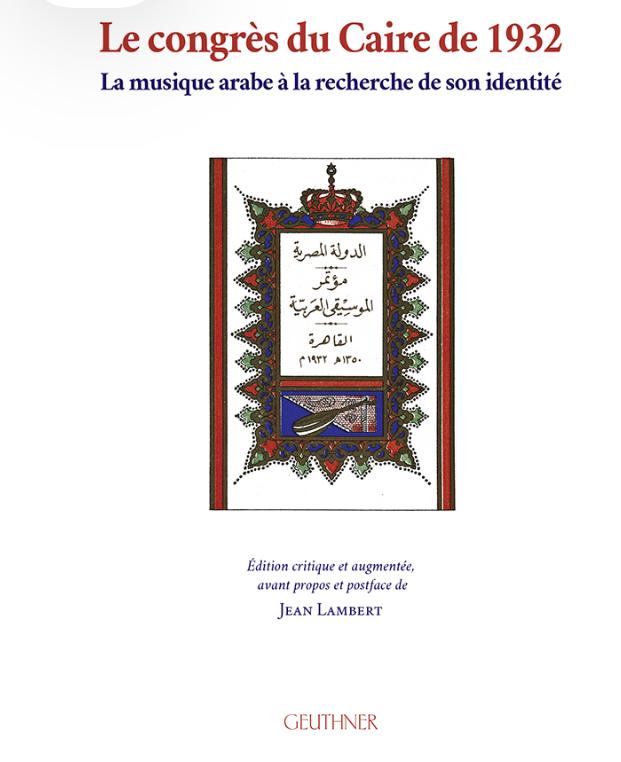
ARTICLES SIMILAIRES

Fred Nevché trimballe Lou Reed d’une factory à l’autre
Briac Saint Loubert Bié
16/04/2025

« Crossroads » : rencontre d’artistes et croisée des regards à Station Beirut
Mathilde Lamy de la Chapelle
15/04/2025

Daniel Alhaiby ou la flûte « enchantée » dans tous ses états
Zeina Saleh Kayali
13/04/2025

Le « Helm » de Paola
Mathilde Lamy de la Chapelle
10/04/2025

Fadia Tomb El Hage chante pour Ihsane
Zeina Saleh Kayali
09/04/2025

Fantaisie pour flûte et piano à Paris par Elie Sawma et Huiryeong Park
Zeina Saleh Kayali
21/03/2025

Création mondiale à Paris de la Passion selon les enfants de Zad Moultaka
Zeina Saleh Kayali
19/03/2025

Avec « Le Chemin de croix » de F. Liszt, le Festival du Bustan coche un niveau d’excellence jamais égalé
Gisèle Kayata Eid
17/03/2025

Les Jeudis musicaux de Saint Maron : sortir du drame par la beauté
Zeina Saleh Kayali
13/03/2025
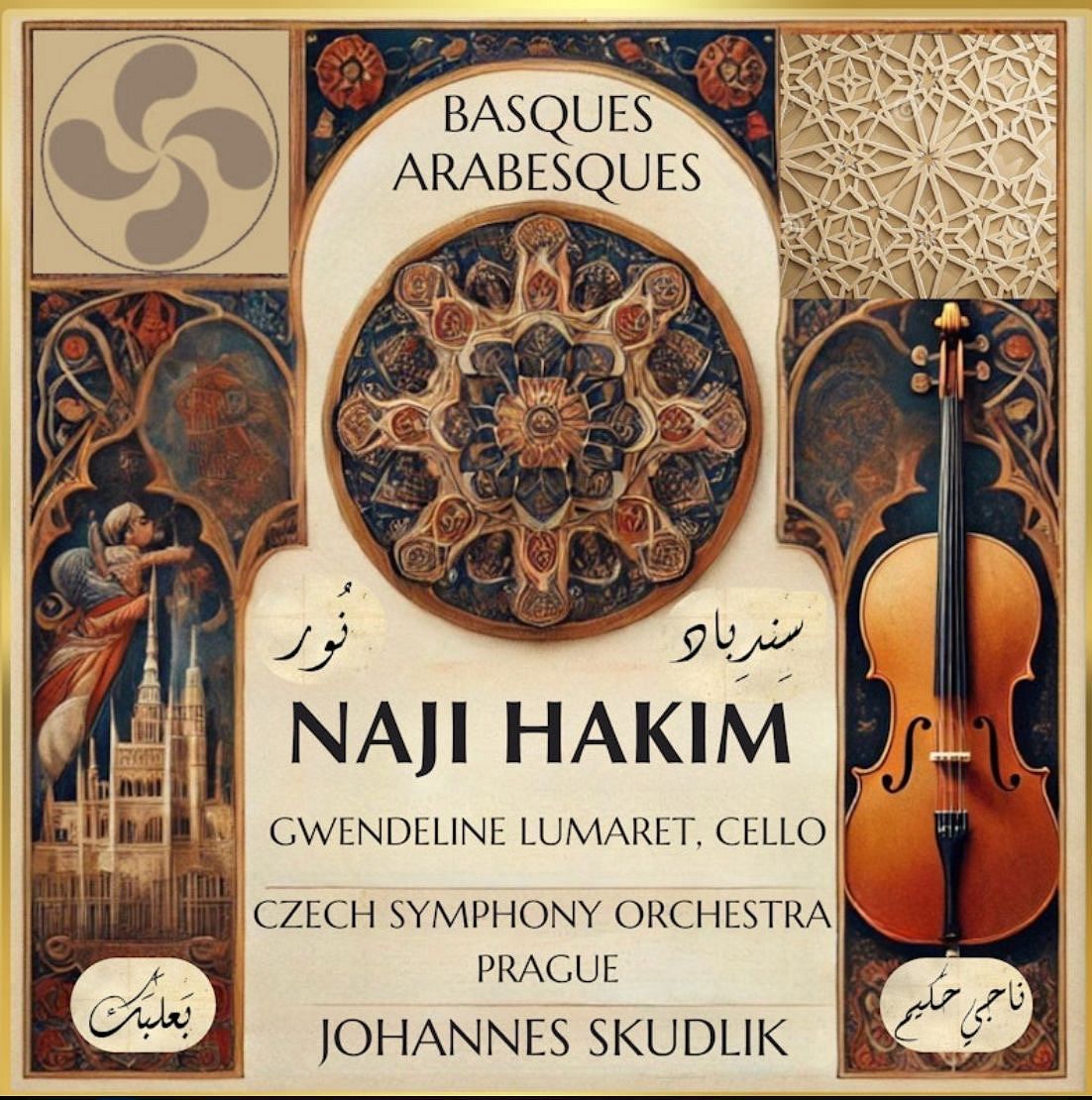
'Basques Arabesques' de Naji Hakim : rencontre de cultures et de rythmes
Zeina Saleh Kayali
09/03/2025
