
Entre Amnistie et Amnésie: Maha Baaklini Laurens
12/02/2025

À l’occasion des 50 ans du début de la Guerre civile libanaise (1975- 1990), « Entre Amnistie et Amnésie, où est passé le souvenir de la Guerre civile ? » est une série d’articles publiée par l’Agenda Culturel. Cette tribune offre un espace d’expression pour partager des souvenirs, des ressentis, ainsi que des blessures et cicatrices (parfois encore douloureuses) laissées par la Guerre civile. Les questions s’adressent à toute personne souhaitant partager son témoignage et ses réflexions dans un esprit de dialogue et de sensibilisation, afin de contribuer à prévenir tout retour à la violence.
Témoignage de Maha Baaklini Laurens
En repensant à la Guerre civile, quels souvenirs ou récits marquants vous viennent à l'esprit ? Qu'ils aient été vécus directement ou transmis par la famille et les amis, comment ont-ils façonné votre identité ?
La guerre je l’ai vécue personnellement par courts épisodes lors de mes vacances au Liban. Je vivais à Paris pour mes études. Certains souvenirs restent nets, bien identifiés chronologiquement d’autres confus comme figés dans un « non temps »
Le premier très marquant a pour cadre mon village. Un village druzo chrétien du Mont Liban. Par une après-midi printanière, des voitures, vans, camions arrivent bondés de personnes fuyant les massacres dans leur village cherchant refuge auprès des habitants chrétiens du nôtre. Je les vois débouler de leurs véhicules, hagards, épouvantés. Une jeune femme a l’air hypnotisée. Contre son cœur une masse couverte de ses paumes. Elle dessert son étreinte et découvre ahurie un oreiller. Dans la précipitation et la frayeur du départ elle l’avait emporté à la place de son nourrisson. Son regard ! Un abîme de douleur !
Son visage demeure gravé dans ma mémoire comme l’expression incarnée de l’horreur de cette guerre.
La douceur des figues.
Profitant d’une brève accalmie une amie chiite donne rendez-vous à ma sœur à la ligne de démarcation près du Musée de Beyrouth. Les yeux embués elle lui remet un panier de figues de leur verger : « question de ne pas déroger à nos habitudes ! »
Jamais auparavant ce fruit n’avait provoqué autant d’émotion chez moi.
Une nuit noire de bombardements. Nous dévalons les escaliers depuis le roof où mes parents habitaient pour nous réfugier au deuxième étage rejoints par d’autres voisins. Nous étions parqués dans un couloir obscur. Je cherche à distraire les enfants, tremblotants en leur inventant des histoires drôles ; ils finissent par s’endormir aux premières lueurs de l’aube. Je m’assoupis à mon tour sur le canapé des voisins. Les obus s’étaient tus. Vers 6 h je suis réveillée par des voix d’enfants. Ils étaient dans le couloir, les yeux alourdis par le sommeil, vêtus de leur uniforme d’école les cartables sur le dos, un sandwich à la main s’apprêtant à rejoindre le car de ramassage scolaire. Pour rien au monde cette mère n’aurait sacrifié un jour d’école.
Ma grand-mère et le sang
La « guerre de la montagne » qui opposait les milices chrétiennes à celles des Druzes battait son plein. Ce fut le moment où ma grand-mère qui s’était toujours auto- soignée forte de sa qualité de veuve d’un médecin, a jugé bon de s’administrer une forte dose d’aspirine connue pour « renforcer le sang ». Résultat : Une hémorragie interne qui a nécessité son hospitalisation urgente dans un hôpital de la région. L’hôpital en zone chrétienne était limitrophe d’un village Druze. Le stock de sang dont il disposait en cette période d’afflux massif de combattants blessés était vite épuisé ; nous lançâmes un appel au don de sang dans notre village. Des dizaines de jeunes, combattants pour la plupart, y répondirent. Des Chrétiens majoritairement mais aussi quelques jeunes Druzes. Le sang prélevé dépassant de loin les besoins de ma grand-mère l’excédent s’est vite trouvé absorbé par de grands blessés venus du front. J’étais amusée par l’idée que le sang de ces volontaires druzes ait pu sauver la vie des ennemis qu’ils combattaient avec acharnement.
Et puis il y a tous ces éclats de rire incoercibles dans les moments les plus critiques, une langue qui fourche sous l’effet du stress et les fous rires fusaient contagieux. Par la magie de l’humour le drame se muait en légèreté. Un humour salvateur qui ne s’est pas démenti y compris dans les heures les plus sombres de ce pays. En dépit du déchaînement de la violence la vie gardait un goût de convivialité qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une douce saveur de figue.
La Guerre civile a-t-elle laissé des traces dans votre vie aujourd’hui ? Si oui, lesquelles ?
N’ayant perdu aucun proche dans la folie des hostilités j’ai eu la chance contrairement à des milliers d’autres d’échapper au traumatisme de ceux qui pleurent un être cher mort ou lourdement handicapé. Mes « fractures » relèvent des blessures collectives.
Avant la guerre j’avais le sentiment de vivre dans un cocon sécurisé. C’est ce sentiment de sécurité, de foi en l’avenir qui me déshéritait au fil des années. La vie me paraissait désormais vulnérable et le lendemain incertain. Le « demain si nous sommes encore vivants » qui précédait au Liban toute ébauche de projet dont je ne pensais pas être si imprégnée se rappelait à moi brutalement quand par exemple, rentrant de Beyrouth je recevais un appel téléphonique d’amis français m’invitant à un dîner prévu un mois plus tard. Comment peuvent-ils être sûrs d’être encore là dans mois ? Vivants ou demeurant au même endroit ?
Dans vos moments de réflexion, comment exprimez-vous ou gérez-vous vos pensées et vos sentiments liés à la guerre ? Est-ce à travers des conversations, des œuvres artistiques, le silence ou d'autres moyens ?
Cette prise de conscience de la fragilité de l’existence à l’âge de l’insouciance a été par moments un aiguillon pour aller vers la vie. Et puiser dans les souvenirs joyeux de cette période de guerre. Ils sont nombreux. Ce sont ceux- là que je me plais à évoquer et à partager. Ceux de la solidarité, des amitiés obstinées à résister à l’avalanche haineuse et ceux des événements heureux. Les autres, je ne les évoque plus de peur d’être submergée par une tristesse stérile et par l’amertume. Le gâchis de toutes ces années de jeunesse. Ces derniers, intacts, peuplent la rive sombre de ma mémoire.
Les guerres de 2006 et 2024 ont-elles fait resurgir des moments, des réflexes ou des émotions de la Guerre civile ?
Jusqu’à ce que des événements tragiques se chargent de les réveiller.
La guerre de 2006 était bien plus qu’une réminiscence de souvenirs puisque je l’ai vécue au Liban. Avant de devenir un cauchemar elle fut un choc, persuadés que nous étions tous que la guerre était derrière nous. J’étais avec mon fils. Pour la première fois j’ai ressenti cette peur, la plus terrible de toutes, malheureusement familière à la grande majorité des Libanais, celle de trembler pour la sécurité de son enfant. Où la plus banale des décisions devenait une question de vie ou de mort. Le coucher dans le lit côté mur ? Et si l’obus le traversait ? Côté fenêtre normalement à l’écart de la ligne de tir ? Et si la vitre s’effondrait ?
J’ai assisté les premiers jours dans l’impuissance générale à la destruction programmée du Liban par l’aviation israélienne, au spectacle de files ininterrompues des personnes déplacées qui évacuaient le Sud ou d’autres régions…
Le même film se déroule en 2024 cette fois, pour moi, sur l’écran télévisé. En matière d’abjection, nous croyions avoir tout vu, atteint les limites de la barbarie mais la réalité est là pour nous narguer et nous rappeler qu’elle demeure plus surprenante que la plus débridée des fictions.
Quand vous racontez vos souvenirs de la guerre aux jeunes générations, quel(s) message(s) voulez-vous leur transmettre ?
Parler de la guerre civile aux jeunes c’est leur raconter des récits puisés dans l’expérience. Leur portée me paraît plus efficace que les discours. A titre d’exemple : les combattants chrétiens et Druzes de mon village qui se vouaient une haine féroce jurant d’occire jusqu’au dernier de ceux du camp adverse filent aujourd’hui le grand amour, s’invitent au mariage de leurs enfants et célèbrent ensemble les grandes fêtes. Leurs morts jadis élevés au rang de martyrs - héros sont aujourd’hui oubliés ; leur souvenir dérange parce qu’il rappelle cette période qu’ils s’ingénient à occulter. Quel sens donner à ces vies brisées et à leurs proches éplorés ? Quel sens à part la vanité de cette mort ?
Lancés dans la spirale de la violence à l’appel des chefs de leurs communautés, ceux-là mêmes qui ont conduit le Liban et son peuple à la ruine, ils se sont apaisés sitôt ces derniers avaient signé un accord de paix.
Rappeler à la génération actuelle la fugacité et l’inconsistance des alliances. Les alliés d’hier devenus les ennemis d’aujourd’hui selon que les intérêts de leurs chefs de file tournent.
Rappeler à ceux qui caressent le fantasme d’une mosaïque d’États mono communautaires qu’une telle structure ne peut être salutaire, que les guerres intestines étaient des plus meurtrières.
Que la haine et le rejet de l’Autre sont les pendants de la peur et de la méconnaissance de l’Autre et loin de nous préserver elles nous conduisent à l’étiolement et l’asphyxie.
Aujourd’hui, trente-cinq ans après la fin de la guerre civile et plus de cinq années de crises violentes et éprouvantes, comment envisagez-vous l’avenir du Liban ? Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer pour construire cet avenir ?
Le Liban change ! Les Libanais sont épuisés et n’aspirent qu’à la paix. Leurs vœux les plus ardents aujourd’hui est de pouvoir accéder de nouveau à leurs économies pour retrouver la dignité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. En réunissant indistinctement toutes les communautés dans le malheur et la privation, la catastrophe financière et humanitaire de ces dernières années a paradoxalement réussi là où le système confessionnel a échoué : rappeler aux Libanais qu’ils partagent une communauté de sort. Les centaines de milliers de manifestants lors de « la révolution de la faim » le rappellent. Les effigies des leaders communautaires protecteurs s’effritent. La recrudescence récente des mariages mixtes qui bouleversent les cadres confessionnels ne trompe pas.
Autant de signes interprétés comme tels par les nouvelles générations sont porteurs de germes d’espoir pour l’avenir
Si je parviens à faire passer aux jeunes de mon entourage l’idée que le vivre ensemble dans ce pays n’est pas une malédiction mais un destin à réinventer et qu’une histoire commune ne peut s’écrire avec une plume trempée dans le sang je pourrais peut-être apporter une très modeste contribution à l’édifice du Liban de demain.
Lire les autres témoignages ici.
Si vous désirez vous exprimer et témoigner, cliquez ici
ARTICLES SIMILAIRES
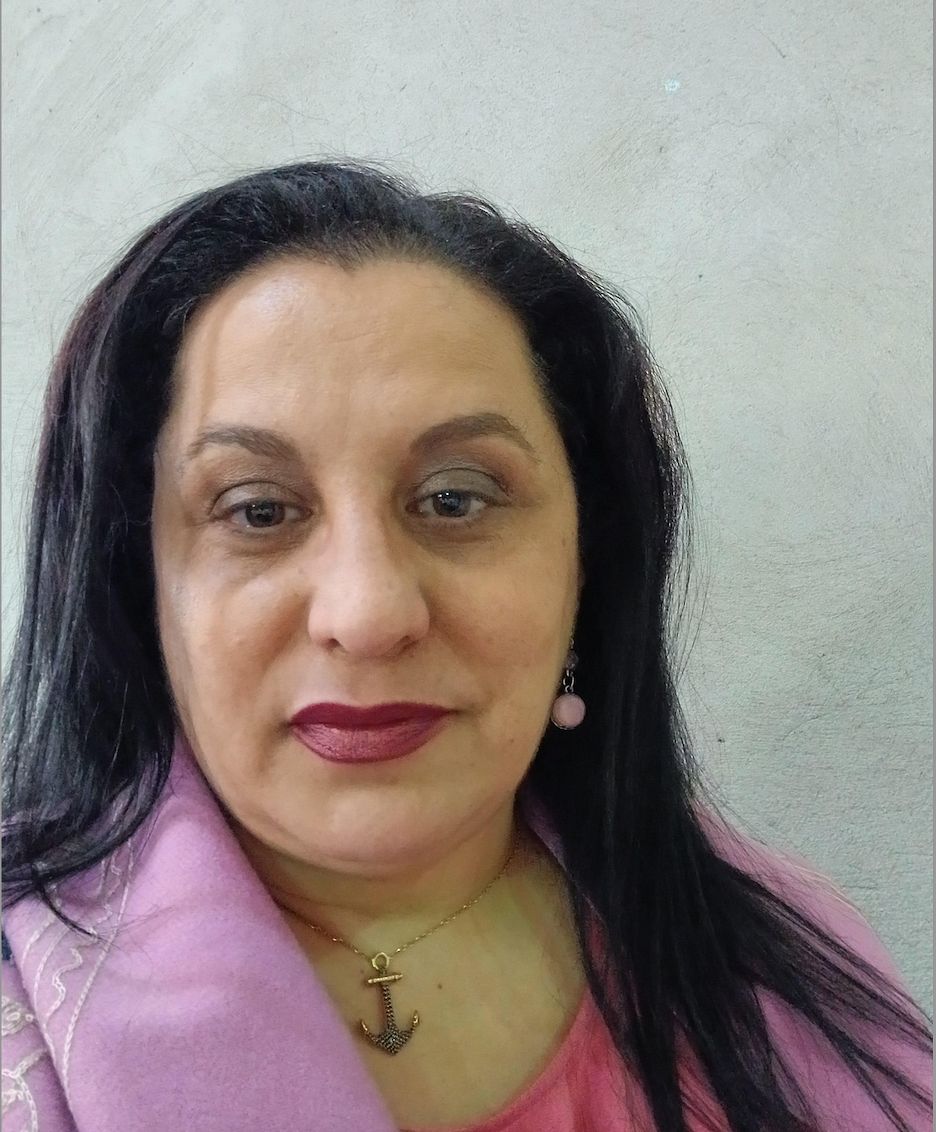
Entre Amnistie et Amnésie : Dima Habib Haddad
13/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nayla Romanos Iliya
11/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nabil Abou-Dargham
10/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Gisèle Kayata Eid
09/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Elie-Pierre Sabbag
06/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nicole Fayad
01/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nagy Rizk
31/03/2025
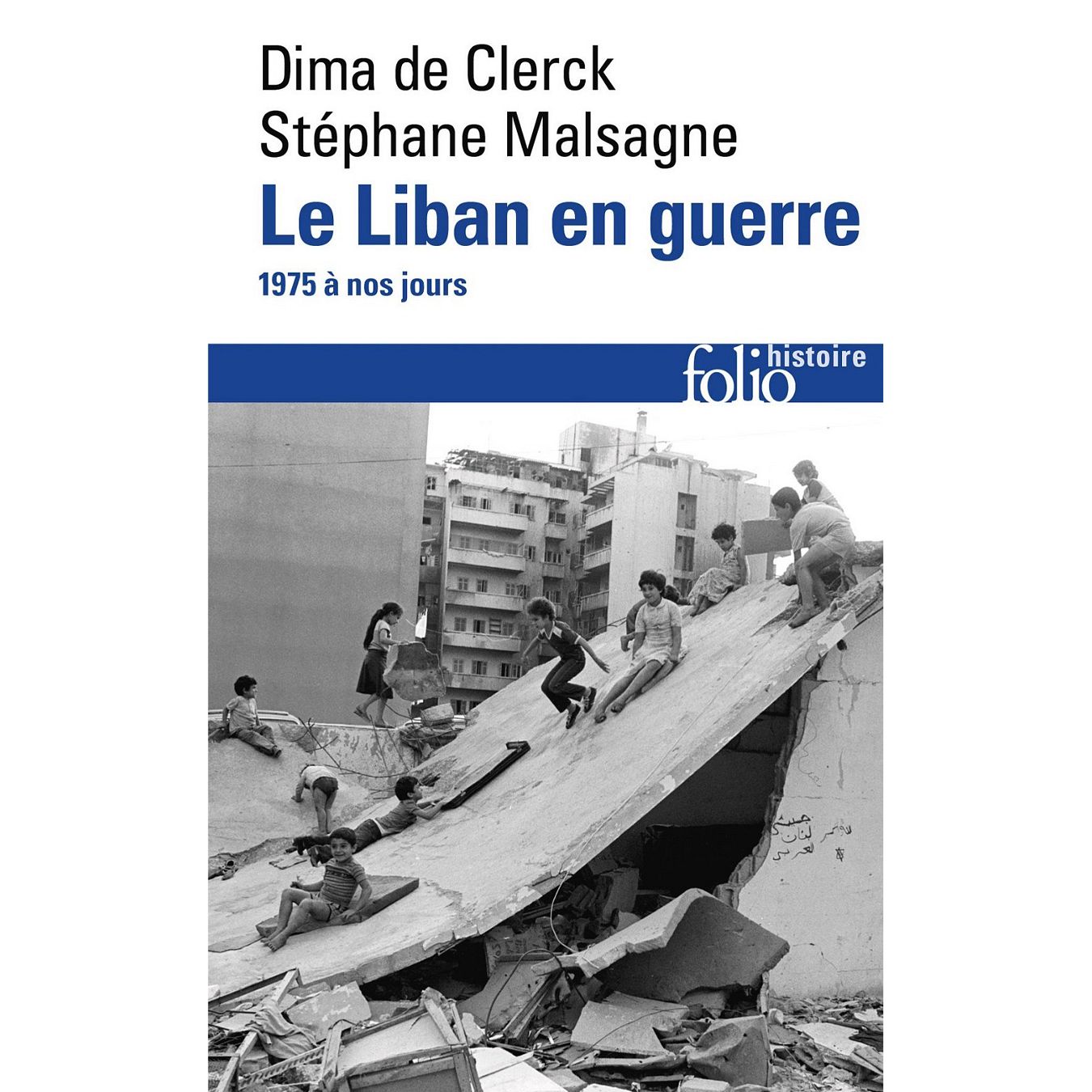
Entre Amnistie et Amnésie : 'Le Liban en guerre (1975 à nos jours)'
19/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Rita Khawand Ghanem
10/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Najwa Bassil Pietton
10/03/2025
