
Entre Amnistie et Amnésie : Nayla Romanos Iliya
11/04/2025

À l’occasion des 50 ans du début de la Guerre civile libanaise (1975- 1990), « Entre Amnistie et Amnésie, où est passé le souvenir de la Guerre civile ? » est une série d’articles publiée par l’Agenda Culturel. Cette tribune offre un espace d’expression pour partager des souvenirs, des ressentis, ainsi que des blessures et cicatrices (parfois encore douloureuses) laissées par la Guerre civile. Les questions s’adressent à toute personne souhaitant partager son témoignage et ses réflexions dans un esprit de dialogue et de sensibilisation, afin de contribuer à prévenir tout retour à la violence.
Témoignage de Nayla Romanos Iliya, architecte et artiste.
En repensant à la Guerre civile, quels souvenirs ou récits marquants vous viennent à l'esprit ? Qu'ils aient été vécus directement ou transmis par la famille et les amis, comment ont-ils façonné votre identité ?
En repensant à la guerre civile, de nombreux souvenirs me reviennent en mémoire; un vécu qui laisse des traces indélébiles.
La liste est longue, à commencer par le massacre de Damour en janvier 1976 durant lequel mon cousin est tué sous les yeux de ses parents, eux-mêmes blessés et traumatisés pour le reste de leur vie.
Ma tante tuée à bout portant en 1982, dans une rue de Beyrouth.
Les balles de francs-tireurs évitées de justesse lors de mes passages fréquents entre l’Est et l’Ouest, me déplaçant entre l’université Américaine de Beirut et notre domicile. Les sueurs froides lors des barrages volants. Les nuits passées dans des cages d’escaliers, ou autres abris de fortune. La voiture derrière la nôtre qui est touché par un obus, alors même qu’on me ramenait de l’hôpital à la maison, et j’en passe…
Le plus terrible reste sans doute la nuit du 5 aôut 1989: je quittais le Liban; l’aéroport de Beyrouth était fermé, et la seule issue était un hydroglisseur au départ du port de Jounieh. Alors que nous embarquions, une salve d’obus tirée par les forces syriennes força le bateau à démarrer en urgence. Nous avons dû nous allonger au sol et nous éloigner des fenêtres, tandis que l’embarcation manœuvrait pour éviter les tirs. Plusieurs passagers n’avaient pas eu le temps de monter à bord, et après une accalmie, ils furent placés sur une chaloupe pour tenter de nous rejoindre. Mais une nouvelle salve d’obus frappa, faisant chavirer la petite embarcation, et tous ses passagers furent projetés dans la mer. Parmi eux, il y avait un couple d’amis, chacun portant une de leurs deux fillettes. Dans la panique et le chaos, elles échappèrent de leurs bras, et ont disparu dans la nuit et la mer agitée. On a monté leur maman à bord de l’hydroglisseur, et nous passâmes la nuit ensemble à l’affut de nouvelles, à la porte de la cabine du capitaine. Son mari fut ramené au port, quant aux fillettes, elles ne furent retrouvées dans la mer que le lendemain, sans vie.
La Guerre civile a-t-elle laissé des traces dans votre vie aujourd’hui ? Si oui, lesquelles ?
Oui, la guerre civile a incontestablement laissé des traces dans ma vie. On ne peut pas traverser des expériences aussi marquantes que celles que j’ai vécues sans en garder des cicatrices, voire des traumatismes.
Mais étant de nature profondément optimiste et positive, j’ai puisé dans ces épreuves une force qui m’a permis de les surmonter et d’en tirer quelque chose de constructif. Ces expériences ont renforcé en moi une grande ouverture envers l’autre, ainsi qu’une compassion sincère pour les plus démunis, et pour les causes justes même si elles sont en divergence avec les nôtres.
J’ai compris que dans une guerre civile, « l’autre camp » n’est souvent pas si différent du camp auquel on appartient. Au Liban, le conflit a été largement nourri par des manipulations sectaires qui ont exacerbé les identités religieuses. Pourtant, ayant étudié dans une université mixte où chrétiens, musulmans et druzes se côtoyaient, j’ai grandi entourée d’amis de différentes confessions. Cela m’a appris à aller au-delà des divisions, à reconnaître l’humanité en chacun.
Enfin, ces années de guerre m’ont appris à vivre pleinement l’instant présent, car j’ai connu trop de situations où la vie ne tenait qu’à un fil. Ce sentiment m’accompagne encore aujourd’hui.
Dans vos moments de réflexion, comment exprimez-vous ou gérez-vous vos pensées et vos sentiments liés à la guerre ? Est-ce à travers des conversations, des œuvres artistiques, le silence ou d'autres moyens ?
Je suis architecte, un domaine que j’ai toujours aimé et dans lequel j’ai travaillé de nombreuses années. Puis, peu à peu, la vie m’a conduite vers l’art. C’est ainsi que j’ai commencé à sculpter en 2011, et, naturellement, la sculpture est devenue depuis, à la fois mon occupation principale et ma véritable passion. M’offrant un espace de liberté et d’expression unique, la sculpture m’a permis de remplacer la rigueur cartésienne de l’architecture par l’émotion, l’intuition et une forme d’abandon qui me reconnecte à l’essentiel. C’est aujourd’hui un moyen vital pour moi de canaliser mes ressentis et mes réflexions les plus intimes.
Les conséquences de la guerre civile occupent une place centrale dans mon travail artistique. En 2019, j’ai exposé pour la première fois une série intitulée Flower Power, qui aborde justement le déni collectif autour de notre guerre civile. J’y exprime le constat que, malheureusement, en tant que Libanais, nous n’avons pas réellement tiré de leçons de ce conflit. Il y a une tendance marquée à enfouir les souvenirs, à éviter toute confrontation avec cette mémoire douloureuse.
Et c’est précisément cette absence de travail de mémoire qui, selon moi, nous expose à la répétition des mêmes erreurs. À travers mes œuvres, je tente d’ouvrir un espace de dialogue, de réflexion, et de transmission – autant pour moi-même que pour ceux qui les regardent.
Les guerres de 2006 et 2024 ont-elles fait resurgir des moments, des réflexes ou des émotions de la Guerre civile ?
J’habitais Hong Kong lors de la guerre de 2006, je ne l’ai donc pas vécue directement. En revanche, en 2024, j’étais au Liban, et dès le début de la guerre, nous avons quitté Beyrouth pour notre maison de montagne, un cadre privilégié, à l’abri des agressions quotidiennes.
L’arrivée de réfugiés en location dans la maison voisine m’a profondément troublée. Je ressentais un mélange d’inquiétude et de désir de me rapprocher de ces familles, de m’enquérir de leur situation, de leur poser des questions. C’était un sentiment étrange, car d’un côté, les réflexes de protection resurgissaient, ce qui était normal suite aux attaques occasionnelles des Israéliens, même dans des villages éloignés des zones de conflit. Mais de l’autre côté, je voulais rester ouverte et m’engager dans une forme de dialogue, ce que je fis. Très rapidement, au bout de quelques semaines à peine, l’afflux croissant des réfugiés a transformé le paysage humain et social des villages essentiellement chrétiens où ils se sont réfugiés. Ce phénomène créait un sentiment d’inconfort et une certaine appréhension de l’autre.
Toutefois, en dépit de nos différences culturelles, de notre manière d’être, de notre façon de nous exprimer, de nous habiller, la véritable aspiration de ces gens était la même que celle de chacun d’entre nous : vivre en sécurité, mener une vie ordinaire, loin de la violence.
La conclusion évidente pour beaucoup était qu’il existait deux Liban, deux mentalités, deux façons de voir et d’être. Pour ma part, je pense qu’il existe effectivement une forme de dichotomie dans notre pays. Mais j’ai l’espoir que ces derniers événements, et les prises de conscience qu’ils suscitent, finiront par changer la donne. J’ai l’espoir que nous apprenions à apprécier nos différences, qui, idéalement, au lieu de nous diviser, peuvent nous enrichir — et surtout contribuer à bâtir un Liban à la hauteur de sa réputation : un exemple de vivre-ensemble.
Quand vous racontez vos souvenirs de la guerre aux jeunes générations, quel(s) message(s) voulez-vous leur transmettre ?
J’ai remarqué que la jeune génération vit aujourd’hui de manière étonnamment isolée, souvent enfermée dans une forme de ghetto social, bien plus que nous ne l’étions à leur âge. Ils n’ont certes pas connu la guerre, mais la plupart n’en ont que vaguement entendu parler, alors même que leurs parents sont, pour la plupart, issus de cette génération marquée par le conflit.
Le message que je souhaite leur transmettre est simple mais essentiel : informez-vous. La guerre civile n’est pas un épisode lointain ni détaché de votre réalité. Elle a façonné le pays dans lequel vous vivez aujourd’hui — un pays encore paralysé par ses séquelles, par la corruption qu’elle a nourrie, et par les crises successives qui en ont découlé. Connaître cette histoire, c’est aussi comprendre votre propre identité. Vous ne pouvez pas avancer sereinement dans l’avenir si vous vivez dans une bulle déconnectée de votre passé.
Aujourd’hui, trente-cinq ans après la fin de la guerre civile et plus de cinq années de crises violentes et éprouvantes, comment envisagez-vous l’avenir du Liban ? Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer pour construire cet avenir ?
Comme je l’ai dit au début de notre entretien, je suis de nature positive et optimiste. Cela ne signifie pas que je sois naïve, imaginant un avenir radieux, sans embuches !
Mais je ressens malgré tout une énergie nouvelle qui tente d’aller dans la bonne direction — portée sans doute par l’arrivée d’un nouveau président et d’un nouveau gouvernement. Bien sûr, la corruption est encore profondément ancrée dans le pays, et le contexte géopolitique régional et international pèsera lourdement sur notre futur. Mais j’ose espérer qu’à l’échelle du pays, les Libanais prendront enfin conscience des erreurs du passé et comprendront la nécessité d’une entraide sincère pour bâtir un État de droit et avancer ensemble.
Quant à mon rôle dans ce processus, il est clair pour moi. En tant qu’artiste, j’utilise mon art pour exprimer ce que je considère comme un engagement personnel et un devoir de mémoire. J’ai toujours eu à cœur de toucher les gens à travers mes œuvres, de susciter une émotion ou une réflexion, qu’ils soient amateurs d’art ou simples citoyens. J’espère donc avoir l’occasion, que ce soit par le biais d’expositions ou d’installations dans l’espace public, de porter un message qui fasse écho à notre vécu collectif, et qui contribue, à sa manière, à faire évoluer les consciences.
Photo : Maher Attar
Lire les autres témoignages ici.
Si vous désirez vous exprimer et témoigner, cliquez ici
ARTICLES SIMILAIRES
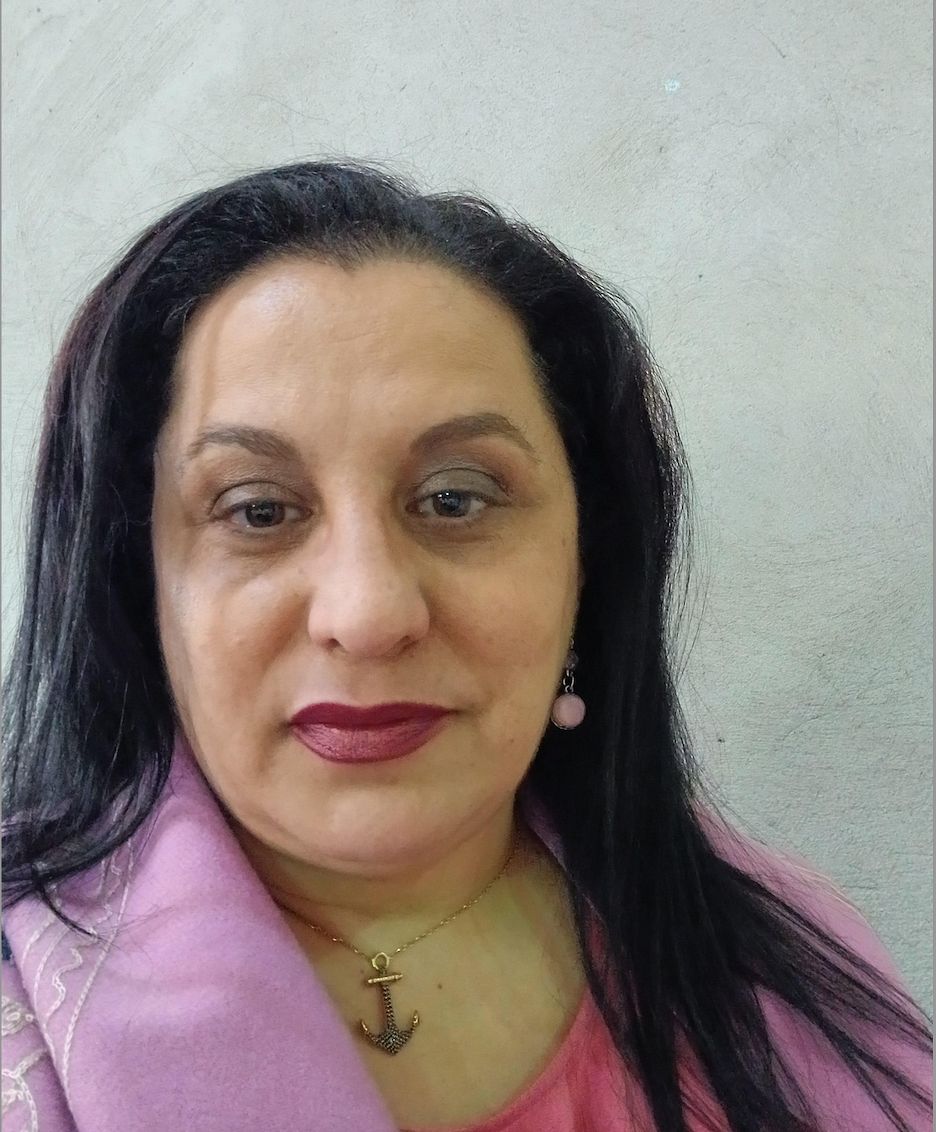
Entre Amnistie et Amnésie : Dima Habib Haddad
13/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nabil Abou-Dargham
10/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Gisèle Kayata Eid
09/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Elie-Pierre Sabbag
06/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nicole Fayad
01/04/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Nagy Rizk
31/03/2025
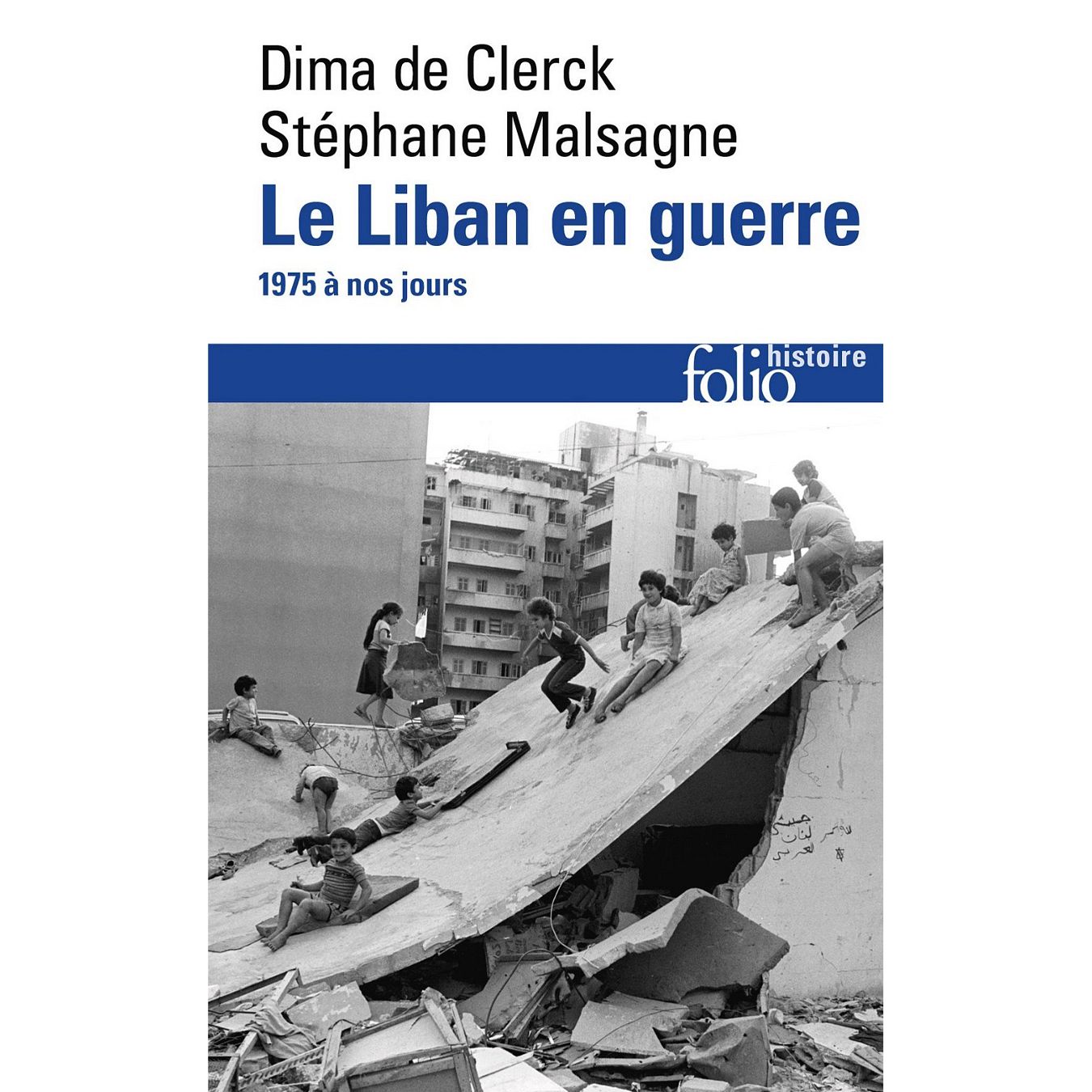
Entre Amnistie et Amnésie : 'Le Liban en guerre (1975 à nos jours)'
19/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Rita Khawand Ghanem
10/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Najwa Bassil Pietton
10/03/2025

Entre Amnistie et Amnésie : Adlita Stephan
01/03/2025
